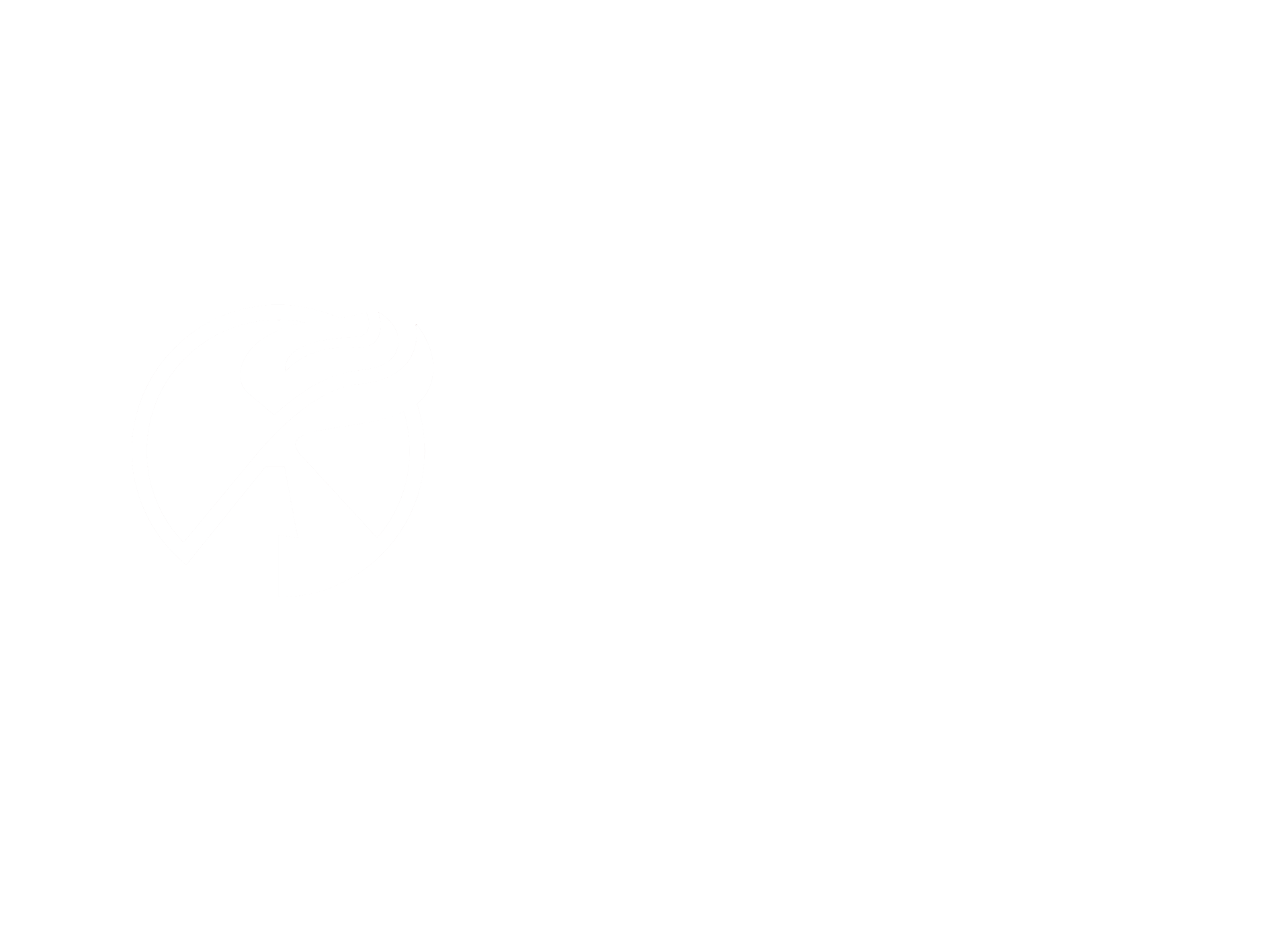Une éruption sous-marine a débuté aujourd’hui au large de l’île d’Epi, à quelques dizaines de kilomètres au sud de Lopévi ou Ambrym, des îles un peu plus connues de cet archipel du Pacifique sud. Lorsque le contact entre le magma et l’eau de mer s’effectue sous une faible profondeur d’eau, la pression n’est pas suffisante pour contenir les gaz. Or, l’eau de mer se vaporise au contact du magma, ce qui rajoute du gaz à l’éruption ! L’activité est très explosive, dite surtseyenne, avec de volumineux panache de vapeur d’eau associés à des gerbes de cendres qui atteignent plusieurs centaines de mètres de hauteur dans ce cas présent. Au moins sept cônes se sont construits sur le bord de la caldeira sous-marine d’East Epi dont les trois plus imposants : Epi A, Epi B et Epi C. Epi B est le lieu de la dernière éruption, en 2004, mais aussi le sommet le moins profond du complexe : il culminait à 34 m sous la surface en 2001 ! La population pouvant craindre un tsunami, à l’image de ce qu’avait fait le voisin Hunga Tonga il y a un an, les autorités ont défini une zone de danger de 10 km de rayon autour du volcan. Sources : Smithsonian Institution, Vanuatu Meteorology & Geo-haazars Department Texte Ludovic Leduc, Objectif Volcans Nos séjours au Vanuatu Pour en savoir plus sur d'autres volcans du Vanuatu, vous pouvez lire l'article de Christian Deloche et Pierre Thomas (Laboratoire de Géologie de Lyon / ENS de Lyon) : Les lacs de lave du volcan d'Ambrym (Vanuatu)
Une éruption sous-marine a débuté aujourd’hui au large de l’île d’Epi, à quelques dizaines de kilomètres au sud de Lopévi ou Ambrym, des îles un peu plus connues de cet archipel du Pacifique sud.
Lorsque le contact entre le magma et l’eau de mer s’effectue sous une faible profondeur d’eau, la pression n’est pas suffisante pour contenir les gaz. Or, l’eau de mer se vaporise au contact du magma, ce qui rajoute du gaz à l’éruption ! L’activité est très explosive, dite surtseyenne, avec de volumineux panache de vapeur d’eau associés à des gerbes de cendres qui atteignent plusieurs centaines de mètres de hauteur dans ce cas présent.
Au moins sept cônes se sont construits sur le bord de la caldeira sous-marine d’East Epi dont les trois plus imposants : Epi A, Epi B et Epi C. Epi B est le lieu de la dernière éruption, en 2004, mais aussi le sommet le moins profond du complexe : il culminait à 34 m sous la surface en 2001 !
La population pouvant craindre un tsunami, à l’image de ce qu’avait fait le voisin Hunga Tonga il y a un an, les autorités ont défini une zone de danger de 10 km de rayon autour du volcan.
Sources : Smithsonian Institution, Vanuatu Meteorology & Geo-haazars Department
Texte Ludovic Leduc, Objectif Volcans
Nos séjours au Vanuatu
Pour en savoir plus sur d’autres volcans du Vanuatu, vous pouvez lire l’article de Christian Deloche et Pierre Thomas (Laboratoire de Géologie de Lyon / ENS de Lyon) : Les lacs de lave du volcan d’Ambrym (Vanuatu)