Surveillance des volcans : Le dioxyde de soufre
Par Philippe Thiran
Le magma, roche en fusion partielle sous la croûte terrestre, contient un mélange de différents gaz dissous.
Les principaux sont la vapeur d’eau (H?O) et le dioxyde de carbone (CO?). Les autres gaz sont présents en quantité variable, le plus important d’entre eux étant le dioxyde de soufre (SO?). Le sulfure d’hydrogène (H?S), le monoxyde de carbone (CO), le chlorure et le fluorure d’hydrogène (HCl et HF) sont également présents en quantité non négligeable.
Le rôle de ces gaz est multiple : déterminer le contenu du magma en matières volatiles, comprendre sa dynamique et fournir un signal annonciateur d’une éruption à venir. Ce dernier rôle est précisément celui du dioxyde de soufre.
Ce dernier est un gaz incolore, dense et toxique dont l’inhalation est fortement irritante. Outre les volcans, il est libéré dans l’atmosphère par de nombreux processus industriels. Il est aussi à l’origine des pluies acides.
Une augmentation soudaine des émissions de SO? peut signaler une remontée du magma et une augmentation de la pression dans le système volcanique, deux facteurs pouvant conduire à une éruption. C’est la raison pour laquelle son niveau d’émission est surveillé en permanence.
Pour ce faire, les scientifiques utilisent des stations de mesure au sol, des instruments aéroportés ou encore des satellites, permettant ainsi de suivre en continu le comportement d’un volcan ou d’un ensemble volcanique et d’en évaluer le niveau de dangerosité.
Les mesures sur le terrain font appel à différentes techniques, telles que :
-
la collecte d’échantillons dans une zone d’émission de fumerolles, par exemple, au moyen de flacons sous vide ;
-
l’usage de détecteurs portables, calibrés pour la concentration de gaz spécifiques tels que le SO? ou le CO? ;
-
la spectrométrie en lumière ultraviolette pour la mesure du dioxyde de soufre ;
-
la spectrométrie infrarouge pour la mesure simultanée de plusieurs gaz présents dans les panaches volcaniques.
Pour les mesures aéroportées, des instruments de mesure comme ceux décrits ci-dessus sont embarqués à bord d’avions ou d’hélicoptères.
Pour les mesures spatiales, des satellites sont équipés d’instruments spécifiques capables de mesurer depuis l’espace la composition des émissions de gaz volcaniques.
Un algorithme permet ensuite de quantifier le SO?, même en très petite quantité. A priori, c’est la meilleure méthode pour recevoir un message d’alerte.
L’éruption phréato-magmatique du volcan costaricien Turrialba, en janvier 2010, est un exemple de la validité du dioxyde de soufre comme annonciateur d’une prochaine manifestation volcanique. En effet, dans les trois mois précédant l’éruption, la concentration de celui-ci dans les gaz s’échappant du volcan passa de 0 à 10 kg/s et atteignit 35 kg/s le jour de l’émission. Elle oscilla autour de cette valeur durant toute la durée de l’éruption.
Dans ce cas, la concentration en SO? fut mesurée simultanément par un capteur au sol et un autre sur satellite.
Un autre exemple est la surveillance du volcan Cumbre Vieja, sur l’île de La Palma, dans l’archipel des Canaries. Les émissions gazeuses y sont mesurées en permanence par des détecteurs embarqués à bord de trois satellites. Un algorithme détermine ensuite la concentration en SO?, même en très petites quantités.
Cette technique paraît être actuellement la plus fiable pour envoyer un message d’alerte.
Rejoignez nous pour aller observer une éruption « en live » en vous inscrivant sur notre mailling list « Spécial Eruption Express«
Bibliographie :
-
Rôle des gaz volcaniques dans le processus d’éruption, Wikipédia
-
SO? annonciateur d’une éruption volcanique, Google AI Overview
-
Imaging measurements of volcanic SO? using space and ground-based sensors, Robin Campion, juin 2011
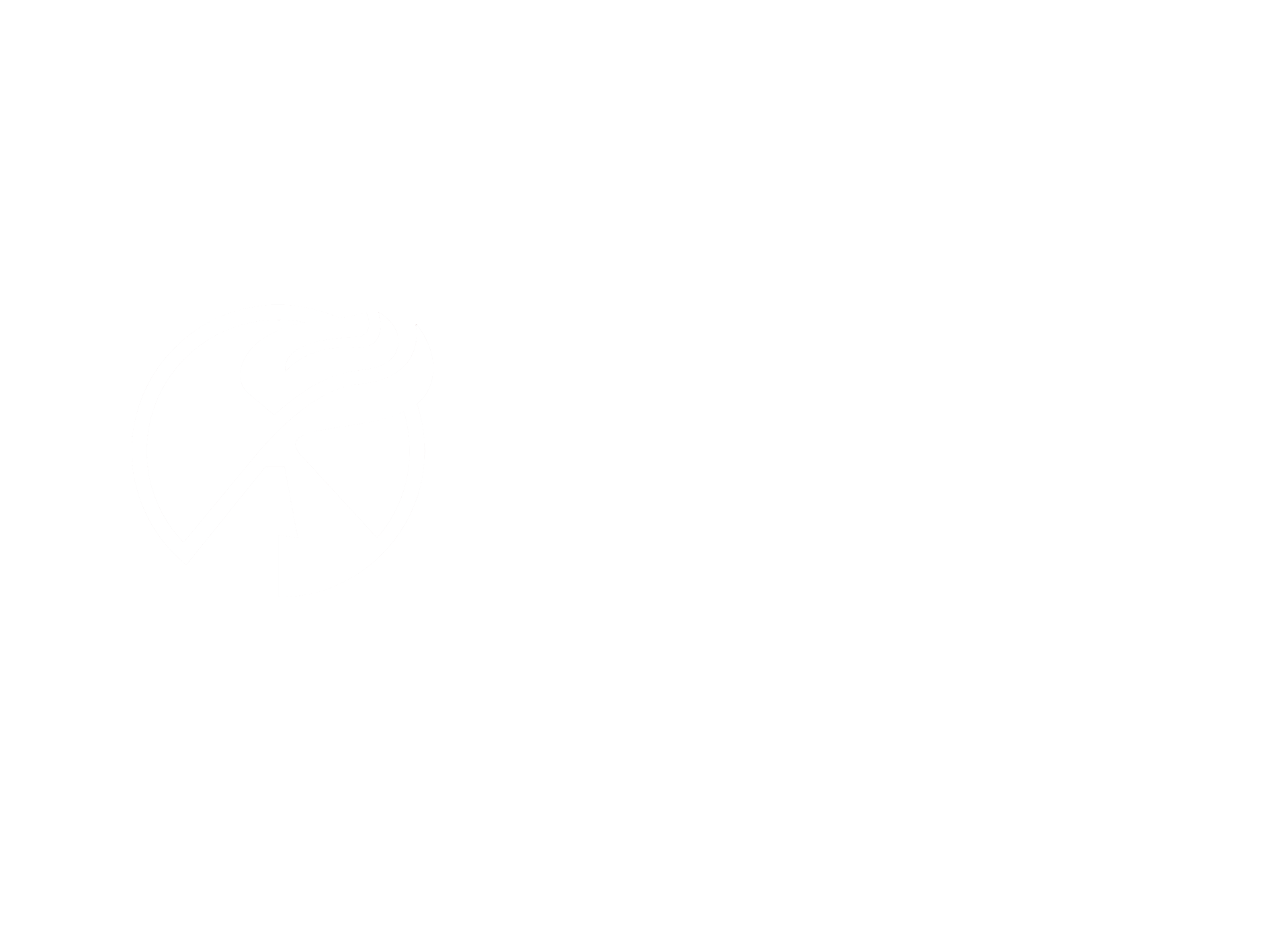

Comments